(Jules Jean) Paul Fort
 Parmi les illustres visiteurs ayant séjourné plus ou moins longtemps dans notre village, il y a Paul Fort dont nous venons de citer un passage de son poème « Saint-Jean-aux-Bois », dans notre article précédent.
Parmi les illustres visiteurs ayant séjourné plus ou moins longtemps dans notre village, il y a Paul Fort dont nous venons de citer un passage de son poème « Saint-Jean-aux-Bois », dans notre article précédent.
Poète et dramaturge français, il est né à Reims (Marne) le 1er février 1872, et est mort à Montlhéry (Essonne) le 20 avril 1960. Il est l’auteur d’une œuvre poétique abondante. Il contribua à donner au quartier du Montparnasse, à Paris, sa renommée artistique et fréquenta quelques uns des écrivains et poètes les plus connus de son temps : Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Pierre Louÿs, André Gide…
Plusieurs de ses poèmes nous sont connus, mis en musique et chantés par Georges Brassens : « Le Petit cheval blanc », « La Marine », « Comme hier », « Si le bon dieu l’avait voulu ».
C’est au début du XXe siècle que Paul Fort séjourna (ou séjournait car nous ne savons pas s’il effectua plusieurs séjours) dans notre village.
Nous n’en connaissons pas la date exacte, mais l’on peut penser que ce fut aux environs de 1907 ou 1908, car son poème est paru dans la revue poétique « Vers et prose » du tome XIII, datée de mars-avril-mai 1908, revue qu’il avait créée en 1905.
Lisant son poème, nous apprenons qu’il prenait pension chez madame Contant, sur la place du village, en face la mairie et si proche de l’église.
Son amie ne passait pas inaperçue. Une belle dame, paraît-il, très élégante, très parisienne et qui promenait un chat enrubanné tenu en laisse.
Dans les rues de Saint-Jean ça devait se remarquer. C’est pourquoi des anciens, hélas disparus depuis longtemps, se souvenaient de ces images de leur enfance de bien avant la guerre de 1914.
Nous citons ci-dessous, les passages les plus caractéristiques de son poème concernant le village.
Saint-Jean-aux-Bois
 Féodal est un bourg ayant une grand’ place toute ronde et faite pour le tournoi, que bordent dans leur harmonieuse mélancolie nos grises maisons du Valois. Doucement la rangée des maisons villageoise accueille une belle église gothique au porche bas, aux verrières qui s’élancent d’un souple bond jet d’eau coloré jusqu’aux ardoises fines et fuyantes (elles vont au ciel) des toits en croix, que sans clocher dominent la Croix et le coq doré sur une lance.
Féodal est un bourg ayant une grand’ place toute ronde et faite pour le tournoi, que bordent dans leur harmonieuse mélancolie nos grises maisons du Valois. Doucement la rangée des maisons villageoise accueille une belle église gothique au porche bas, aux verrières qui s’élancent d’un souple bond jet d’eau coloré jusqu’aux ardoises fines et fuyantes (elles vont au ciel) des toits en croix, que sans clocher dominent la Croix et le coq doré sur une lance.
Féodal est un bourg embrassé de fossés où passe le ru chanteur qu’animent les battoirs, en cadence levés, baissés dans l’air sonore par des bras vertueux et nus qu’il fait bon voir. Le rire des laveuses au chant du ru s’accorde. Les géraniums, les marguerites, les boutons d’or, en leur éclat frileux nuancé par le vent, le disputent dans l’herbe aux linges tendus aux cordes, — aux jaunes, aux blancs, aux rouges mouchoirs, aux bas mouvants.
Chantez, laveuses, claquez, mouchoirs ! Vous ne troublerez pas, c’est moi qui vous le dis, le somme dix fois séculaire du pont-levis, au seuil de ce village où l’école bourdonne, où l’herbe pousse, où l’heure sonne, où la poule glousse et fait ombre à la fourmi, vous ne troublerez pas le rêve du pont-levis : sa porte crénelée en sommeillant s’appuie aux bourrelets de fer de deux tours effilées, portant chapeau pointu et couleur de vieux puits.
J’ai fait l’acquisition d’un petit village français à l’époque où commence à chanter le chardonneret, Saint-Jean-aux-Bois, qui me plaît tout à fait. Il est retrait, il est secret, se cache au cœur d’une forêt, et ne me coûte guère, pourtant, que « trois cinquante » le premier jour, puis tous les jours autant, payés jusqu’à ce jour à l’hôtellerie touchante de cette chère madame Contant : demain madame Contant retouchera sa rente et cela peut durer jusqu’à la fin des temps.
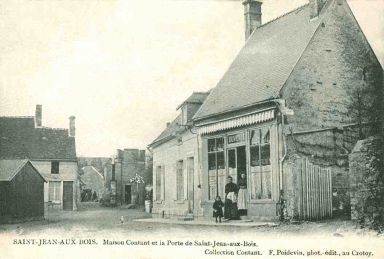 Sans trouble, par nature, aux fantômes qui glissent dans la chambre où je rêve et qui s’ouvre à tous les vents pressentant le poète elle monnoye mes vices, ne faisant que sourire et toucher en comptant. Depuis lors, c’est chez elle qu’un jour l’un, un soir l’autre, j’invite à boire les rois de France, moi bon hôte, les rois valois s’entend, fleurs de discrétion, voire leurs prédécesseurs capétiens charmants. D’autres rois je n’ai cure, je n’en fais pas question.
Sans trouble, par nature, aux fantômes qui glissent dans la chambre où je rêve et qui s’ouvre à tous les vents pressentant le poète elle monnoye mes vices, ne faisant que sourire et toucher en comptant. Depuis lors, c’est chez elle qu’un jour l’un, un soir l’autre, j’invite à boire les rois de France, moi bon hôte, les rois valois s’entend, fleurs de discrétion, voire leurs prédécesseurs capétiens charmants. D’autres rois je n’ai cure, je n’en fais pas question.
La forêt de Compiègne est bien délicieuse et l’on y a mille agréments à regarder les vents frais et bleus du printemps friser comme une écume les futaies tapageuses. Feuilles nouvelles ! Feuilles toutes belles ! Plus que l’émeraude transparente ! C’est d’elles que s’entoure au printemps mon féodal petit Saint-Jean.
…
Mais ce que j’aime en lui, surtout, c’est l’abandon discret et journalier qu’en font ses habitants. Dès la pique de l’aube je me lève et déjà, les bûcherons sont au cœur mystérieux des bois, les femmes, cependant si terribles caquettes, ne bruissent qu’aux lavoirs sur le ru des Planchettes, bientôt l’école avale galopins et fillettes, ce ne sont que de lointains murmures, petits fredons ; et seul, courant Saint-Jean dans mes vieux habits noirs, je reste avec les poules, les oies et les canards, dont le parler ne fait qu’ajouter au silence.
Les mains aux poches, l’œil gai sous mon chapeau Rembrandt, mais l’esprit attentif aux bruits de la lumière, je me recueille, j’écoute, je penche un peu le front, j’entends vieillir le presbytère, le jeu d’or du cadran solaire, le gazon fin entre les pierres de l’église et de la grand’ place, puis, sans que j’aille en brusquer l’air, j’entends renaître en moi de vieux doux airs de danse pour ces tilleuls qui font une ronde si lasse, autour du banc où je m’assoies, attendant un roi de ma race.
…